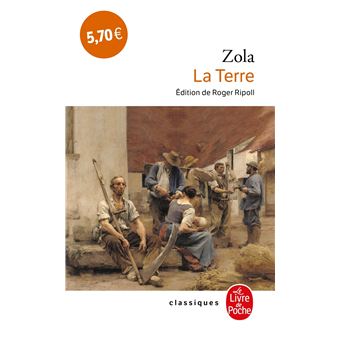
Critique – La Terre – Émile Zola
Quinzième opus de la « saga » « naturelle et sociale » « Les Rougon-Macquart », « La Terre » aurait pu s’intituler « Scènes de la vie paysanne ».
Sauf que la description que fait Émile Zola du monde rural est bien éloignée de la sérénité dégagée par les tableaux de Jean-François Millet.
L’intrigue commence en 1860 et se déroule à Rognes, un village de la plate Beauce. L’atmosphère y est d’emblée orageuse.
La fratrie Fouan se dispute en effet l’héritage du père alors qu’il n’est pas encore passé de vie à trépas, déployant, notamment les deux éléments mâles, Jésus-Christ et surtout l’odieux Buteau dont le comportement n’a rien à envier aux Thénardier, toutes sortes de stratagèmes pour essorer le patriarche.
À part quelques exceptions, tous les individus évoluant dans « La Terre » sont prêts à tout, y compris à trahir leur famille, pour ne rien perdre de leur plus ou moins maigre patrimoine.
Parallèlement, Zola fait évoluer des personnages bien caractérisés autour de ce trio infernal.
À défaut de tous les évoquer, citons les principaux :
- Alexandre Hourdequin est le maire de Rognes, mais surtout un passionné d’agriculture et de nouvelles techniques d’exploitation qu’il expérimente dans son domaine de la Borderie. Cet engouement quasi sentimental pour la terre le conduira à la ruine.
- Jean Macquart, frère de Gervaise qui apparaît dans « L’Assommoir », est l’estranger et le seul de sa famille à ne pas avoir développé de tares. Ayant participé aux campagnes militaires sous le Second Empire, d’où son surnom de « Caporal », il est blessé en Italie. Il reprend alors son ancien métier de menuisier. Lassé et aspirant à la tranquillité, il se fait embaucher par Hourdequin et devient valet de ferme. C’est au retour d’une journée de labeur que le presque trentenaire croise une gamine de quatorze ans emportée par une vache qu’elle tenait fermement avec une corde.
Venant à sa rescousse, il sauve Françoise et tombe sous son charme…
- La terrible Grande, sœur du père Fouan, est « respectée et crainte, non pour sa vieillesse, mais pour sa fortune. »
Plus encore que Buteau et Lise, parce qu’elle est plus intelligente, elle est le personnage le plus diabolique de « La Terre ». Âpre au gain, manipulatrice, roublarde et sans cœur, elle a contemplé sa fille et son gendre mourir dans la misère sans lever le petit doigt et laisse ses petits-enfants « crever la faim » tout en les exploitant sans vergogne. Pour « épargner les chevaux », elle n’hésite pas à atteler son petit-fils Hilarion, un dégénéré qui couche avec sa sœur avant d’abuser de sa grand-mère presque nonagénaire ! Manipulatrice, elle dresse les membres de sa famille les uns contre les autres, même s’ils n’ont pas vraiment besoin de se faire prier pour se détester.
- Les Charles, couple de bourgeois qui a constitué un patrimoine conséquent en exploitant un lupanar à Chartres, tout en envoyant leur fille et leur petite-fille étudier dans un couvent.
Fortune faite, ils se sont retirés à Rognes pour finir leurs jours dans un cadre bucolique.
- Et puis, il y a la Terre de Beauce, la principale protagoniste du récit, qui nourrit, mais qui épuise les corps, les assoiffe ; la Terre si versatile, si changeante au fil des saisons qui se refuse parfois à fournir le pain quotidien, rendant les existences fragiles et ceux qui l’exploitent fatalistes ; la Terre dont les fruits subissent les assauts de la concurrence internationale enfonçant les paysans dans la misère (à ce propos, Zola s’autorise un anachronisme en situant la crise agricole sous le Second Empire alors qu’elle ne surviendra qu’à la toute fin des années 1870).
Elle est si attachante qu’elle est souvent comparée, notamment dans la bouche d’Hourdequin, à une femme qu’on féconde.
C’est à elle que Zola, si féroce avec ses pairs, réserve ses envolées lyriques et poétiques.
« La Terre », publié en 1887, est le seul roman des vingt que compte le cycle des « Rougon-Macquart » à se dérouler à la campagne.
Il est aussi le plus provocateur avec le portrait très sombre qu’il brosse du monde paysan : appât du gain tel qu’il peut conduire à l’éclatement des familles, à la folie, voire aux crimes les plus sordides ; manque d’hygiène pour ne pas dire saleté repoussante (la Grande affirme ainsi : « la sueur, ça sèche, ça ne salit pas ») ; pingrerie ; haines ancestrales ; commérages ; insultes diverses et variées ; obsessions et pulsions sexuelles qui les font se comporter comme des bêtes, qu’ils côtoient de près, au grand dam des autorités ecclésiastiques épouvantées par le comportement de leurs ouailles déchristianisées qui, ne craignant plus le Diable, ne redoutent plus Dieu, faisant s’exclamer l’abbé Godard : « vos vaches ont plus de religion que vous » ; femmes corvéables à merci considérées comme des objets de plaisir et, de temps à autre, la gnôle aidant, comme des punching-balls ; mort d’épuisement des plus misérables, accablés par le labeur, dans une forme de résignation générale ; maltraitance des anciens devenus inutiles et dont on attend la disparition avec impatience pour hériter (« j’aimerais mieux avoir quatre vaches à conduire, qu’un vieux à garder » confie Fanny, la fille de Fouan) ;inceste ; viols ; bagarres ; consanguinité ; alcoolisme ; refus de la science qui porte à faire davantage confiance au rebouteux qu’au vétérinaire ou au médecin et à placer le destin entre les mains d’une sorcière…
Et dans cette atmosphère maléfique, même les moins malintentionnés verse dans les passions tristes, même les pures bergères tombent amoureuses du loup prédateur.
Bref, l’amoralité est partout à Rognes.
Zola pousse le bouchon du naturalisme un peu loin et on peut se demander si l’instigateur du groupe de Médan avait une once de compassion pour cette « race », tellement il est cruel avec ses personnages.
Il est tellement outrancier (cf. scène hallucinante de l’accouchement de Lise et du vêlage de la Coliche qui se déroulent simultanément) que ses procédés littéraires relèvent quasiment de la bouffonnerie dans son acception dramaturgique.
Zola introduit aussi dans son récit sa vision politique qui postule qu’à l’inverse des ouvriers décrits notamment dans « Germinal », les paysans sont résignés.
Les jacqueries des 13e et 14e siècles sont bien lointaines. La fureur qui les caractérisait se limite désormais au cercle familial et entre villageois que la quasi-adoration de l’argent et de la propriété rendent fous, comme s’ils étaient saisis par des pulsions de mort l’anéantissement de l’autre et, conséquemment, de soi.
Il est vrai que la Révolution française est passée par là. « La nuit du 4 août, écrit Zola, avait légalisé les conquêtes des siècles, en reconnaissant la liberté humaine et l’égalité française. »
Bien que majoritaires, les paysans sont passifs face à l’adversité et aux inégalités sociales. Dépourvus de sens du collectif, ils sont profondément individualistes et obsédés par la possession de la terre.
Pire, Zola oppose les deux classes en soulignant que « si le paysan vend bien son blé, l’ouvrier meurt de faim ; si l’ouvrier mange, c’est le paysan qui crève… »
Pourtant, des voix républicaines, souvent venues d’ailleurs, celles de Canon, un mendiant voulant « couper le cou aux riches » , et de Lequeu, l’instituteur « qui avait sucé la haine de sa classe avec l’instruction. » et méprisait ses élèves, s’élèvent pour contrecarrer le soutien à l’Empire.
Et puis il y a l’inénarrable Jésus-Christ, pochard subversif, paillard, et accessoirement redoutable pétomane, rebelle à toute autorité.
Enfin, il y a Jacqueline, la fille du cantonnier, qui travaille à la Borderie depuis ses douze ans. Dès son plus jeune âge, elle subit les assauts des valets de ferme.
Plus tard, elle riposte en séduisant Hourdequin et en le rendant dépendant de ses appas dont elle rationne l’usage, contrairement aux autres jeunes hommes, Jean en tête, en vue d’être couchée sur son testament.
L’auteur de « L’Assommoir » note : « les paysans ne comprenaient même pas que cette catin était leur vengeance, la revanche du village contre la ferme, du misérable ouvrier de la glèbe contre le bourgeois enrichi, devenu gros propriétaire. »
Quoi qu’il en soit, ce presque huis clos rural, que le reste du monde n’effleure que lors de la visite de politiques en campagne électorale ou lors du tirage au sort des appelés bientôt enrôlés pour combattre contre la Prusse, qui porte la caricature et l’art de la description, à la fois physique et psychologique, à son apogée, est d’une immense drôlerie.
À condition d’apprécier l’humour noir.
EXTRAITS
- Mme Charles […] avait le masque épais et à gros nez des Fouan, d’une paix et d’une douceur de cloître, une chair de vieille religieuse ayant vécu à l’ombre.
- Mangée de chlorose, trop grande pour ses douze ans, elle avait la laideur molle et bouffie, les cheveux rares et décolorés de son sang pauvre, et comprimée d’ailleurs par son éducation de vierge innocente, qu’elle en était imbécile.
- Son bec-de-lièvre le faisait saliver, il bégayait sans pouvoir expliquer les choses, l’air caduc pour ses vingt-quatre ans, d’une hideur bestiale de crétin.
- Elle était très sale […], chafouine, noire, d’une maigreur rouillée de vieille aiguille ; tandis que la gaillard, sans tarder, lui empoignait les cuisses à nu sous la table. Le mari, ivre mort, bavait, ricanait, gueulait que la garce n’en aurait pas trop de deux.
- À quoi bon trembler et s’aplatir, acheter le pardon, puisque l’idée du diable les faisait rire désormais, et qu’ils avaient cessé de croire la grêle, le tonnerre, aux mains d’un maître vengeur ?
- Rognes était sans prêtre : plus de messe, plus rien, l’état sauvage.
- Il m’a paru tout long, tout mince, avec une figure de Carême qui n’en finit plus.
- Quand on n’a plus rien, il n’y a pas de justice, il n’y a pas de pitié à attendre.
Vous devez être connecté pour publier un commentaire.
+ There are no comments
Add yours