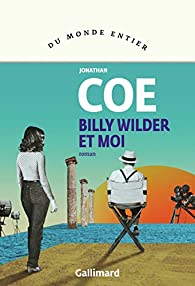
Critique – Billy Wilder et moi – Jonathan Coe – Gallimard
En admirateur du 7ème art (il a écrit une biographie de Humphrey Bogard et de James Stewart), Jonathan Coe est parti à la rencontre du grand réalisateur que fut Billy Wilder.
Pour cerner l’homme, il donne la parole à un personnage totalement inventé prénommé Calista, une jeune grecque aux faux airs de « Funny face », compositrice de musiques en amateur et embauchée sur le tournage de « Fedora » comme traductrice. Désormais presque sexagénaire, celle-ci se souvient.
A l’époque, elle est tellement inculte en matière de cinéma qu’elle ignore que son « patron » a réalisé quelques chefs-d’oeuvre de la comédie américaine (« Certains l’aiment chaud » en 1959, « La garçonnière » en 1960…) mais aussi des films tragiques comme « Sunset Boulevard » en 1950. « Fedora », sorti en 1978, appartient à la seconde catégorie et il eut beaucoup de mal à le monter. Il pourrait clamer « Fedora, c’est moi » tellement l’identification du cinéaste d’une autre époque à la star déchue et vieillissante est évidente.
Car les difficultés financières qu’il rencontre pour payer son avant-dernière œuvre sont le signe de la mort d’un certain cinéma, celui importé aux Etats-Unis par des artistes souvent juifs dont Ernst Lubitsch fut l’un des représentants les plus talentueux et un maître pour l’Autrichien Wilder qui se moque gentiment des films de requin (deux ans plus tôt était sorti « Les dents de la mer », préfiguration des blockbusters qui envahiront les écrans), de prouts (référence au « Shérif est en prison » de Mel Brooks, 1974) et des « jeunes barbus » que sont Spielberg, Coppola et Scorcese.
Il définit alors son cinéma : « on ne souligne pas les choses. On les suggère. On a recours à un peu de subtilité, on pousse le spectateur à faire le travail ». Il ajoute, pour souligner l’air du temps : « l’histoire a commencé depuis à peine dix minutes, et la fille est déjà à genoux en train de faire une pipe au gars ». Il n’imagine évidemment pas Greta Garbo, Ingrid Bergman ou encore Audrey Hepburn dans une telle posture !
Bien qu’il soit installé aux States depuis quarante ans, il est résolument européen comme le rappelle le formidable Iz Diamond, l’un des principaux scénaristes du réalisateur qui soupçonne son ami Billy de faire des films pour retrouver sa mère disparue (rappelons qu’en 1945, il réalisa « Les usines de la mort », un documentaire sur la découverte des camps de concentration par les Alliés). « J’étais toujours en train de guetter son visage » confie-t-il après avoir visionné « La liste de Schindler » qu’il aurait rêvé de monter.
Le roman plein de charme de Jonathan Coe, qui abandonne là sa critique caustique de la société britannique, est un vibrant, nostalgique et poignant hommage au cinéma des années 1950-1960 via le portrait de l’un de ses flamboyants ambassadeurs, un homme à l’ironie cruelle hanté par la disparition des siens et qui porte en lui la tragédie de l’histoire. Jamais l’aphorisme « l’humour est la politesse du désespoir » n’a autant de sens qu’ici.
Petit bémol : la narratrice Calista, un modèle de naïveté et de gaucherie dont les histoires de cœur et le récit de ses relations avec ses filles présentent peu d’intérêt.
EXTRAITS
- Tu ne comprendras jamais (…) le pouvoir consolateur d’un bon brie.
- A Hollywood (…), on ne commence pas sa matinée en lisant les « Cahiers du cinéma » (…). On consulte le box-office.
- Je suis toujours stupéfait, à chaque fois que je reviens en Allemagne, de la manière dont tous les nazis ont simplement disparu à la fin de la guerre, en un claquement de doigts.
- S’il n’y a pas eu d’Holocauste, où est ma mère ?
- Ernst Lubitsch pouvait faire davantage avec une porte fermée que la plupart des cinéastes avec une braguette ouverte.
- Avec l’âge, les espoirs rapetissent et les regrets grandissent.
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.
+ There are no comments
Add yours